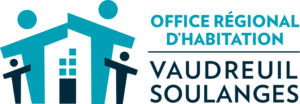Logement
Bien se préparer en vue du 1er juillet
Des services en logement disponibles sur le territoire
Les effets de la crise du logement touchent désormais toutes les sphères de la population. La MRC et le Comité logement Vaudreuil-Soulanges lancent une série d’outils contenant des informations générales, des conseils pratiques et des rappels réglementaires afin d’aider les locataires, les intervenant.e.s et employé.e.s municipaux à se diriger vers la bonne ressource pour faire face aux différents cas de figure qui pourraient se présenter à eux.
N’hésitez pas à consulter les onglets ci-dessous.


Recherche de logement
- Les logements abordables sont difficiles à trouver. N’attendez pas à la dernière minute pour effectuer vos recherches.
- Parlez-en à votre entourage et visitez, Marketplace, kijiji.ca, lespac.com et louer.ca.
- Essayez de signer un nouveau bail avant de résilier votre bail actuel.
- Préparez-vous en réalisant un budget et une liste de vos anciens propriétaires.
- Ces références pourront démontrer votre capacité de payer.

Augmentation de loyer
- Le propriétaire doit vous envoyer un avis de modification au bail écrit 3 mois avant la fin du bail pour un bail de 12 mois ou plus.
- Vous avez 1 mois pour répondre par écrit à compter de la réception de l’avis, sinon il sera considéré que vous acceptez l’augmentation et le renouvellement de votre bail.
Vous pouvez :
- Accepter le renouvellement du bail avec ses modifications.
- Refuser et proposer un autre montant si vous croyez que l’augmentation est injustifiée et renouveler votre bail. Vous pouvez contacter Mon logement, mes droits pour vous assister
dans votre démarche. Votre propriétaire pourrait s’adresser au Tribunal administratif du logement pour faire fixer le prix. - Ne pas renouveler votre bail et quitter le logement à la fin du bail.
- Il faut toujours conserver des preuves écrites et datées de vos échanges!
- Soyez vigilants à toute autre modification qui pourrait accompagner l’augmentation de loyer.
- Attention : les immeubles de 5 ans et moins ne sont pas soumis à des limites d’augmentation de loyer.

Reprise de logement et éviction
- Pour un bail de plus de 6 mois, le propriétaire doit vous envoyer un avis de reprise de logement ou un avis d’éviction 6 mois avant la fin de votre bail.
- Vous avez 1 mois pour y répondre à compter de la réception de l’avis, sinon vous serez mis en position d’avoir refusé de quitter le logement.
- Vous avez le droit de refuser et/ou demander une indemnité : mois de loyer gratuits, frais de déménagement, etc.
- Devant le Tribunal, le propriétaire aura le fardeau de prouver qu’il entend réellement reprendre le logement pour la raison mentionnée dans son avis.
- Aucune reprise ne peut être faite si vous avez 70 ans et +, que vous habitez votre logement depuis plus de 10 ans et que vos revenus respectent la limite établie pour l’octroi d’un logement à prix modique. Informez-vous sur les exceptions à cette règle!

Le dossier de crédit
Il est préférable d’obtenir par vous-même votre dossier de crédit en biffant les informations sensibles (NAS) et en faire une photocopie au besoin.
Pour faire une étude de crédit, le propriétaire :
- Doit avoir votre consentement écrit.
- Doit vous demander votre nom complet, votre adresse et votre date de naissance.
- N’a pas besoin de votre numéro d’assurance sociale (NAS) pour l’enquête (vous pouvez demander votre dossier de crédit à Equifax et biffer votre NAS).

Attention! Vous êtes lié à votre bail
- Informez-vous sur vos recours et vos responsabilités avant d’abandonner votre logement.
- Si des réparations sont nécessaires, vous pouvez demander à votre propriétaire de les réaliser.
- S’il s’agit d’une question de salubrité, vous pouvez faire appel à votre municipalité pour vous aider.
Informez-vous
- Le programme Allocation-logement
Le programme s’adresse à des personnes et à des familles à faible revenu qui utilisent une part trop importante de leur budget pour se loger. Vous pouvez bénéficier du programme si vous êtes locataire, chambreur ou propriétaire. - Tribunal administratif du logement
www.tal.gouv.qc.ca
1 877 907-8077

Ressources d'aide
Services en logement
Office régional d’habitation Vaudreuil-Soulanges
Demande pour un logement social et du soutien afin de se trouver un logement.
450 218-6994
orhvs@orhvs.ca
Demande en ligne pour les demandes de logement à loyer modique : www.orhvs.ca
Service d’aide en recherche de logement (SARL)
450 218-6994, poste 4226
sarl@orhvs.ca
Mon logement, mes droits
Information sur ses droits et recours en tant que locataire.
438 308-5973
monlogementmesdroits@hotmail.com
Réseaux
Accompagnement dans la recherche de logement pour les personnes immigrantes.
450 424-5727
Sans frais: 1 877 737-8582
info@reseauxvs.ca
reseauxvs.ca
Hébergement
Hébergement La Passerelle
Hébergement d’urgence pour les femmes et enfants suite à une situation de violence conjugale.
Ligne d’urgence 24/7 450 424-6010
info@hebergementlapasserelle.com
hlapasserelle.com
L’Aiguillage
Hébergement d’urgence aux personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir.
450 218-6418
sra@aiguillage.ca
hebergement@aiguillage.ca
aiguillage.ca
Arc-en-ciel (Vaudreuil-Soulanges)
Hébergement pour personne ayant une problématique en santé mentale ou vivant une situation de détresse émotionnelle.
450 424-7006
arcencielvs@gmail.com
L’Antichambre
Hébergement pour les jeunes de 12 à 17 ans en situation précaire ou d’itinérance.
450 373-9887
Texto : 438-833-9836
*Situé à Salaberry-de-Valleyfield
Municipalités et ressources institutionnelles
Municipalités et villes
Les coordonnées de votre municipalité sont disponibles sur leur site internet ou dans les bulletins municipaux.
Ligne 3-1-1
Le service 3-1-1 est disponible pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour tous les appels non urgents nécessitant une intervention municipale (insalubrité du logement, etc.).
Info-social 8-1-1
Consulter un professionnel en intervention psychosociale au téléphone.
8-1-1 option 2
2-1-1
2-1-1
Pour tout autre besoin, consultez le service 2-1-1 (bottin de ressources en ligne) pour le territoire de Vaudreuil-Soulanges.
8 h à 18 h / 7 jours
211 ou 1 844 387-3598
Par clavardage :
Lundi au vendredi 8 h à 18 h,
samedi et dimanche 9 h à 16 h
Comité logement Vaudreuil-Soulanges
Mission :
Favoriser la concertation entre les acteur.trice.s en logement et hébergement du territoire et encourager la mise en œuvre d’initiatives visant l’accès à un logement abordable ou à un hébergement ainsi que promouvoir les droits des citoyen.e.s relativement au logement.
Composition du comité :
- Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (santé publique)
- Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges
- L’Aiguillage
- L’Office régional d’habitation de Vaudreuil-Soulanges
- Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
- Mon logement, mes droits
- Réseaux
- Carrefour Jeunesse Emploi
- L’ARC-EN-CIEL Vaudreuil-Soulanges
- Ville de Vaudreuil-Dorion
- Ville de Saint-Lazare
- Hébergement La Passerelle
Nous tenons à remercier le Comité urgence logement de Beauharnois-Salaberry de nous avoir partager le contenu de leurs outils de communications et de nous avoir permis de s’en inspirer afin de créer les nôtres.
Programmes d’amélioration de l’habitat
Programmes de rénovation domiciliaire de la Société d’habitation du Québec
Le programme RénoRégion vise à aider financièrement les propriétaires-occupants à faible revenu qui vivent en milieu rural à réaliser des travaux pour corriger les défectuosités majeures de leur résidence, qui doit être d’une valeur de 150 000 $ ou moins (excluant le terrain).
Le programme est administré par la Société d’habitation du Québec, qui en confie l’application aux municipalités régionales de comté (MRC) et à certaines municipalités.
Pour être admissible, vous devez :
- être propriétaire de la résidence et l’occuper à temps plein ;
- être citoyen canadien ou résident permanent ;
- ne pas avoir bénéficié du programme RénoRégion (PRR) dans les 5 dernières années ;
- ne pas avoir bénéficié du programme Rénovation Québec dans les 5 dernières années ;
- la résidence à rénover doit être de type unifamilial, jumelé, duplex, ou une maison mobile sur fondation / pieux;
- la valeur du bâtiment au compte de taxes municipales 2021, en excluant le terrain, doit être inférieure ou égale à la valeur maximale établie par la MRC, soit 150 000 $. Fournir une copie du compte de taxes municipales ;
- Le bâtiment ne doit pas être construit dans une zone inondable 0-20 ans ni dans une zone de glissement de terrain ;
- avoir un revenu, pour l’ensemble des membres de votre ménage, inférieur ou égal au revenu maximal admissible indiqué au tableau ci-après. Se référer à la ligne 15000 de la déclaration des revenus Fédérale. Additionner le revenu des propriétaires et 25 % du revenu des autres membres du ménage. Fournir une copie complète de l’avis de cotisation Fédérale et de la déclaration des revenus Fédérale de chaque personne du ménage habitant à la maison. Les revenus d’un travailleur autonome devront tenir compte de la déduction pour amortissement au formulaire T2125 de la déclaration des revenus :
| Nombre de personnes dans le ménage | Couple ou 1 personne |
2 à 3 personnes |
4 à 5 personnes |
6 à 7 personnes |
| Revenu admissible |
moins de 33 500 $ (95%) Jusqu’à 45 500$ |
moins de 37 000 $ (95%) Jusqu’à 49 000 $
|
moins de 46 500 $ (95%) Jusqu’à 58 500 $
|
moins de 58 000 $ (95%) Jusqu’à 70 000 $
|
- L’aide financière maximale pouvant être versée par le programme RénoRégion est de 20 000$ ou de 25 000$ lorsque le revenu du ménage est égal ou inférieur au NRA. Le taux d’aide peut varier entre 20% et 95%, selon votre revenu. Le calcul de l’aide financière est basé sur le coût le plus bas entre celui de la plus basse soumission et le coût établi à partir de la liste de prix de la SHQ.
Le programme d’adaptation de domicile vise à aider une personne handicapée à adapter son domicile afin qu’elle puisse y accomplir ses activités quotidiennes. Il consiste en une aide financière versée au propriétaire du domicile pour la réalisation de travaux d’adaptation essentiels et fonctionnels.
Le programme est administré par la Société d’habitation du Québec, qui en confie l’application aux municipalités et aux municipalités régionales de comté (MRC). Elles déterminent les travaux admissibles en fonction d’un rapport fourni par un ergothérapeute.
Le programme Petits établissements accessibles (PEA) vise à améliorer l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite aux petits établissements. Ce sont les propriétaires et les locataires d’établissements commerciaux, d’affaires et de réunion non soumis à une obligation légale en matière d’accessibilité qui pourront se prévaloir du programme.
Plus précisément, ce programme a pour objectif de fournir une aide financière aux propriétaires et locataires des bâtiments visés pour la réalisation de travaux permettant d’appliquer les exigences d’accessibilité du Code de construction (RLRQ, chapitre B-1.1, r 2).
Le programme est administré par la Société d’habitation du Québec, qui en confie l’application aux municipalités régionales de comté (MRC) et à certaines municipalités.
Mandataires des Programmes de rénovation (PRR), d’adaptation à domicile (PAD) et Petits établissements accessibles (PEA)
Contact : Véronique Bouchard, Technologue en architecture
Tél. : 450 287-0136
PAD-RR@hotmail.com
J5A 2G1
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site Internet de la Société d’habitation du Québec au : www.habitation.gouv.qc.ca

Insalubrité morbide
Trajectoire intersectorielle en insalubrité morbide
De nombreux signalements sont rapportés par les différents services municipaux et les professionnels de la santé concernant des individus qui accumulent des objets ou des déchets de façon excessive, les menant à vivre dans des conditions de vie insalubres. Depuis 2011, plusieurs acteurs de première ligne s’interrogent sur la meilleure façon d’intervenir dans les situations d’insalubrité morbide, constatant que leurs efforts respectifs n’étaient pas suffisamment arrimés.

De ce constat est apparue, en 2013, la nécessité de former un comité de travail intersectoriel composé d’une pléiade d’acteurs institutionnels, municipaux et communautaires. Au terme d’un travail rigoureux, le comité a mis sur pied, en juin 2015, la première trajectoire intersectorielle en insalubrité morbide dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Résultat de nombreuses réflexions, cette trajectoire élaborée selon une approche intersectorielle, a pour objectif d’élaborer des pistes de solutions fonctionnelles et efficaces quant à la résolution de ces dossiers. Les acteurs impliqués ont poursuivi leur travail afin d’assurer le suivi de cette trajectoire. À ce jour, l’ensemble des municipalités (23) faisant partie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges a adopté une résolution signifiant leur adhésion aux modalités de collaboration dans le cadre de cette trajectoire.
La trajectoire intersectorielle en insalubrité morbide de Vaudreuil-Soulanges est le processus par lequel une situation d’insalubrité morbide sera traitée en veillant à la prévention, au dépistage, à la référence et à l’accès à des services d’aide en matière d’insalubrité morbide par l’évaluation et des interventions concertées. L’objectif général est de clarifier le mandat, les rôles et les responsabilités de chaque instance, pour ainsi donner une vision commune des actions à poser lors de ces situations. Plus spécifiquement, elle vise à corriger ou à réduire la situation d’insalubrité et à améliorer la qualité de vie de la personne affectée ainsi que son entourage, à mettre en place les outils nécessaires au partenariat et, finalement, à s’assurer du respect des lois en vigueur et de la confidentialité.
Composition du comité de suivi de la Trajectoire
|
Nom |
Organisme/établissement/municipalité |
|
Johanne Girard |
Chef d’administration de programme Réseau adulte psychosocial – CISSSMO |
|
Marie-Claude Boutin |
Conseillère-cadre aux partenariats DPSMD – CISSSMO |
|
Denis Bourdeau |
CETAM |
|
Bruno Beaulieu |
Sûreté du Québec |
|
Michel Vaillancourt |
Directeur du service des incendies de Coteau-du-Lac |
|
Julien Lamarre |
Technicien en prévention incendie au service des incendies de Coteau-du-Lac, Saint-Télesphore, |
|
Anik Courval |
Directrice du service d’urbanisme Saint-Zotique |
|
Éric Flynn |
Technicien en prévention incendie au service des incendies de L’Île-Perrot |
|
Éric Martel |
Directeur adjoint et coordonnateur de la sécurité civile, Rigaud, Très-Saint-Rédempteur |
|
Étienne Bergevin |
Directeur général adjoint, Pincourt |
|
Stéphane Séguin |
Directeur adjoint au service des incendies de Pincourt |
|
Robert Grimaudo |
Maire de St-Lazare et membre de la table SCI |
|
Julie Dubois |
Technicienne en prévention incendie pour les municipalités : Rivière-Beaudette, Saint-Polycarpe, Saint-Clet, Sainte-Marthe, Sainte-Justine-de-Newton |
|
Marilyn Gauthier |
Technicienne en prévention incendie pour les municipalités : Rivière-Beaudette, Saint-Polycarpe, Saint-Clet |
|
Gabrielle Wibault |
ASI Santé mentale |
|
Andrée Gaudet |
Directrice du Service d’aide à domicile Vaudreuil-Soulanges |
|
John Gladu |
Directeur de l’Aiguillage |
|
Gabrielle Chartrand |
Travailleuse de milieu |
|
Mélanie Courchesne |
Organisatrice communautaire – CISSSMO |